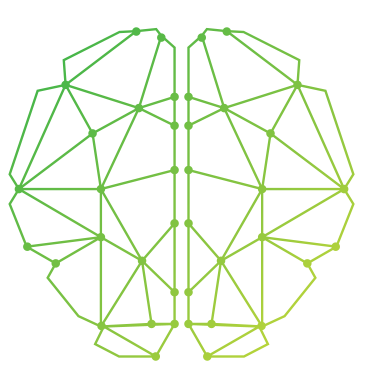Demande d’injonction provisoire : l’urgence artificielle n’est pas une urgence de nature 9-1-1
Le 3 mars 2025, la juge Nancy Bonsaint, de la Cour supérieure, rejette une demande d’injonction interlocutoire provisoire visant à permettre à Les Entreprises de la Batterie inc. d’utiliser un terrain ne lui appartenant pas afin d’entamer d’importants travaux de construction sur son immeuble. Ce jugement rappelle qu’une partie ne peut contribuer à une situation d’urgence pour ensuite l’invoquer au soutien de sa demande d’injonction provisoire. Le résumé des faits La Demanderesse, Les Entreprises de la Batterie inc., est propriétaire d’un immeuble qui fait l’objet de travaux de construction depuis mars 2021, afin d’être transformé en hôtel et de servir d’agrandissement à l’Auberge qu’elle exploite déjà1. Le Défendeur est propriétaire d’un hôtel et d’un terrain contigu à l’immeuble visé par les travaux, lequel est notamment utilisé comme stationnement pour sa clientèle2. Les travaux de construction de la Demanderesse se déroulent initialement en deux phases distinctes, soit de mars à novembre 20213, puis du 23 août 2022 au mois de juillet 20244. Dans le cadre de ces phases, les Parties ont convenu de diverses ententes afin que la Demanderesse puisse utiliser un (1) espace de stationnement du Défendeur, moyennant compensation5. Le 14 février 2025, la Demanderesse informe le Défendeur qu’elle entend entamer une nouvelle phase de travaux (la phase 3), et ce, dès le 28 février 20256. Elle annonce également au Défendeur que, dans le cadre de ces nouveaux travaux, il lui sera maintenant nécessaire d’utiliser la moitié de son immeuble, ce qui correspond à six (6) espaces de stationnement, ainsi que d’en relocaliser l’entrée pour une période de plus de deux (2) ans7. Elle indique, au surplus, qu’elle aura besoin d’avoir un accès complet à l’immeuble du Défendeur pour quelques jours au printemps 20258. La Demanderesse allègue que les travaux de construction sur son immeuble doivent débuter d’urgence le 28 février 20259. Le Défendeur s’oppose à un empiétement d’une telle ampleur pendant une période de deux (2) ans supplémentaires alors qu’il doit composer avec les inconvénients découlant des travaux de construction de la Demanderesse depuis déjà plus de quatre (4) ans, d’autant plus que cette dernière ne lui offre pas une contrepartie qui soit raisonnable ou juste dans les circonstances. Le 28 février 2025, la Demanderesse présente une Demande introductive d’instance pour l’émission d’ordonnances en injonction interlocutoire provisoire, en injonction interlocutoire et en injonction permanente, en déclaration d’abus et en dommages-intérêts modifiée en date du 28 février 2025 devant la juge Bonsaint10. Au stade de l’injonction interlocutoire provisoire, la Demanderesse demande au Tribunal de rendre une ordonnance temporaire visant à lui permettre d’avoir accès aux six (6) espaces de stationnement du Défendeur afin de poursuivre la mobilisation de son chantier11. Elle réclame également le remboursement des honoraires qu’elle a engagés pour présenter sa demande d’injonction. La Demanderesse allègue que les travaux d’agrandissement de son hôtel « se chiffrent à plusieurs dizaines de millions de dollars et sont d’une grande envergure »12. Elle allègue également qu’il est « urgent que le projet de transformation et de construction d’un hôtel dans son Immeuble se poursuive et qu’il ne soit pas interrompu en raison des agissements du défendeur »13. La Demanderesse affirme qu’une interruption des travaux de construction à son immeuble entraînerait non seulement d’importants retards à l’échéancier des travaux qui s’étalent sur les deux (2) prochaines années, mais également d’importants coûts additionnels en lien avec divers extras des entrepreneurs qu’elle a engagés pour procéder à la transformation et à la construction de son immeuble14. Évidemment, le Défendeur s’oppose à la demande d’injonction interlocutoire provisoire, notamment au motif que les faits allégués par la Demanderesse ne satisfont pas au critère de l’urgence15. C’est donc dans ce contexte que s’inscrit la décision de la juge Bonsaint. Les critères de l’injonction interlocutoire provisoire Tout comme le fait la juge Bonsaint dans son jugement, rappelons d’abord les principes juridiques en lien avec le recours en injonction interlocutoire provisoire : Les critères donnant ouverture à une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire sont : l’urgence ; l’existence d’une question sérieuse, d’une apparence de droit; l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable; la prépondérance des inconvénients16. Il s’agit d’un recours discrétionnaire et exceptionnel qui ne doit être accordé qu’avec parcimonie et dans le respect de conditions strictes17. Le critère de l’urgence En contexte de demande en injonction interlocutoire provisoire, le critère de l’urgence est « d’une importance capitale »18 ; s’il n’y est pas satisfait, la demande ne peut tout simplement pas être accueillie19. Les tribunaux décrivent souvent cette urgence comme « une urgence de nature 9-1-1 »20. Seuls les cas « extrêmement urgents » doivent entraîner l’octroi d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire21. Pour que les tribunaux concluent à l’existence d’une telle urgence, celle-ci ne doit pas découler du délai à introduire le recours; elle doit être « immédiate et apparente » et ne pas découler de l’absence de diligence de la Demanderesse22. Autrement dit, « l’urgence alléguée doit être réelle et ne pas être créée artificiellement par la personne qui la soulève »23. La juge Bonsaint retient du dossier que le Défendeur n’a été informé qu’un quelconque empiétement serait nécessaire sur son lot que le 31 janvier 202524. En effet, à aucun moment avant le mois de janvier 2025 la Demanderesse ne l’a informé de ses réelles intentions par rapport à ses travaux25. Ce n’est que le 14 février 2025 que la Demanderesse a officiellement avisé le Défendeur de la nature de l’empiétement qu’elle envisageait pour la troisième phase de ses travaux, soit l’utilisation d’au moins la moitié de son terrain, et ce, du 28 février 2025 au 31 mars 202726. À la suite de la présentation de sa contestation par le Défendeur, la juge Bonsaint retient que la Demanderesse savait que la troisième phase de ses travaux commencerait au début de l’année 2025 depuis déjà plusieurs mois27. Elle détermine que la Demanderesse « n’a pas traité la question de l’accès au stationnement comme étant une matière urgente à régler »28. La Demanderesse tente de justifier ce manque de proactivité par le fait qu’il lui était impossible d’informer le Défendeur de ses besoins en espace avant 2025, puisque l’échéancier des travaux lui était toujours inconnu29. Or, la juge Bonsaint considère que de telles explications ne justifient tout simplement pas le temps qu’a pris la Demanderesse pour intenter sa demande en injonction interlocutoire provisoire contre le Défendeur30. Au contraire, la documentation transmise par la Demanderesse au soutien de sa lettre du 14 février 2025, dont le plan de l’immeuble du Défendeur et l’échéancier préliminaire des travaux, comporte la mention « 2024 »31. Vu ce qui précède, la juge Bonsaint ne peut que conclure que la Demanderesse était au courant depuis plusieurs mois que les travaux de construction sur son immeuble devaient commencer en 202532. À ce sujet, les propos de la juge Bonsaint sont clairs : « Le Tribunal comprend que les dates d’un échéancier préliminaire des travaux puissent faire l’objet d’un changement, mais rien n’indique qu’il est “urgent” de débuter les travaux de construction le 28 février 2025. […] la demanderesse aurait dû agir dès janvier 2025 »33. En effet, les faits relatifs à la problématique de l’accès à l’immeuble du Défendeur lui étaient connus depuis l’automne 2024 et, sinon, certainement depuis janvier 202534. Ils auraient dû susciter les échanges tenus entre les procureurs des Parties en février 2025 bien avant, soit minimalement en janvier 202535. La tenue de discussions ou de tentatives de règlement La Demanderesse a également soutenu que des discussions ou des tentatives de règlement peuvent avoir un impact sur le critère de l’urgence au stade de l’injonction interlocutoire provisoire36. La juge Bonsaint rejette cet argument puisqu’aucune négociation réelle n’a eu lieu, sinon des appels ratés en novembre et décembre 2024, puis en janvier 2025, et que les faits relatifs à la problématique de l’accès à l’immeuble du Défendeur sont connus par la Demanderesse depuis l’automne 2024, sinon certainement depuis janvier 2025. Ainsi, la juge Bonsaint rejette la demande en injonction interlocutoire provisoire, considérant que la Demanderesse demande au Tribunal de conclure à l’urgence d’émettre une telle ordonnance, afin d’accéder à la moitié du stationnement du Défendeur pendant deux (2) ans, alors qu’elle-même n’a pas traité la question de la nécessité d’avoir accès au stationnement comme étant une urgence qui se devait d’être résolue avant de procéder à la réalisation de la troisième phase des travaux de construction37. Ce qu’il faut retenir Le critère de l’urgence est d’une importance capitale en matière d’injonction interlocutoire provisoire. Il doit absolument être respecté pour que le Tribunal accorde une telle demande. Dans son appréciation des faits et des allégations en lien avec une demande d’injonction interlocutoire provisoire, le Tribunal doit veiller à ce que l’urgence soit réelle, de type 9-1-1, et qu’elle ne soit pas créée par la partie qui la demande. Un délai causé par la partie demanderesse ne peut pas entraîner l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire contre la partie défenderesse. Finalement, la tenue de discussions de règlement et/ou de négociations qui ne sont pas sérieuses ne permet pas à une partie de pallier le délai couru entre le moment de sa connaissance des faits qui justifient l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire et le dépôt de sa demande. La diligence est donc de mise dans la gestion et la préparation de tels dossiers et favorisera l’obtention de l’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire. Entreprises de la Batterie inc. c. Biron, 2025 QCCS 608, par. 1 et 10 (ci-après, le « Jugement »). Jugement, par. 4. Jugement, par. 10. Jugement, par. 16 à 19. Jugement, par. 10 à 18. Jugement, par. 27. Jugement, par. 3 et 27. Jugement, par. 3. Jugement, par. 2. Jugement, par. 6. Jugement, par. 7. Jugement, par. 46. Jugement, par. 47. Jugement, par. 48. Jugement, par. 8. Jugement, par. 35 et 37 à 39. Jugement, par. 36. Jugement, par. 41. Id. Jugement, par. 41 et 43. Jugement, par. 42. Jugement, par. 42. Jugement, par. 40. Jugement, par. 61 et 62. Jugement, par. 62. Jugement, par. 64 et 65. Jugement, par. 68. Id. Jugement, par. 74. Jugement, par. 75. Jugement, 76 et 77. Jugement, par. 82. Jugement, par. 82. Jugement, par. 84. Jugement, par. 85. Jugement, par. 83. Jugement, par. 90.